top of page
PAUSE Nell - STUBER Juliette - ROUGE Naomi
Année 2018-2019
TPE 1èreS
Partie I
Les cases et
les jardins créoles
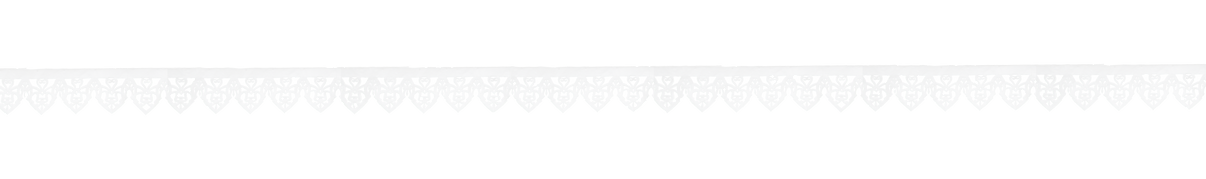



A). Les cases créoles
1). Un peu d'histoire.
À partir du début du XVIIe siècle, les ouvriers et maîtres ouvriers recrutés en diverses régions du royaume de France (Normandie, Bretagne, Anjou, Poitou, Charentes...) seront les pionniers-bâtisseurs des constructions de la Compagnie des Indes et de l'habitat d'une population de colons de plus en plus importante. Ainsi, à l'image des autres colonies du royaume que sont le Québec, les Antilles, la Louisiane, Pondichéry et l'île de France, l'architecture de l'île Bourbon, au XVIIIe siècle, est ancrée dans la tradition, les techniques et le savoir-faire des provinces de l'ouest du royaume de France. Dès la fin du XVIIl siècle, les modèles architecturaux et la manière de bâtir évolueront peu à peu pour tenir compte de la nécessaire adaptation au climat, de l'approvisionnement des matériaux et des influences culturelles. Ainsi, le patrimoine architectural réunionnais est très varié et il existe des maisons créoles pour tous les goûts. « Néna lé tro bel ! Néna lé mizér » écrit Francky Lauret, dans l'œuvre : île de La Réunion, cases créoles. « Il en est de magnifiques. Il en est de misérables » dirions-nous en Français. Les plus grandes s'affichent sur les avenues des grandes villes, témoignages d'un colonialisme passé, et les plus petites au contraire se cachent au fond d’allées ouvrant sur des domaines d'anciennes familles de planteurs. Leurs murs blancs semblent abriter des histoires d'un autre temps, remplies de quiétude et de sérénité, attirant la curiosité du promeneur.
2). Les caractéristiques des cases créoles
Ainsi à la Réunion plus qu'ailleurs, l'architecture est le fruit d’une tradition constamment renouvelée et d’un métissage entre l’Orient et l’Occident. Le registre des cases créoles est un des plus variés, car il s'étend de la grande demeure ancienne à la petite case plus récente, toutes ces maisons étant malgré leurs différences regroupées dans une même famille. Certains modèles ont perduré, même si quelques-uns avec le temps ont été abandonnés. La case créole d'aujourd'hui est l’image d'une évolution, et c'est à quelques éléments extérieurs désormais emblématiques de la case créole, que nous nous sommes intéressés.
3). Conclusion
Les cases à La Réunion se distinguent de par leur variété et leur hétérogénéité : elles varient très fortement en fonction des époques, du statut social des occupants, des procédés techniques ou tout simplement des modes. Est-il dès lors possible de définir un modèle architectural réunionnais ? Il semble bien difficile de les concentrer de manière définitive en un modèle type, en une case qui regrouperait toute la richesse du patrimoine architectural de l'île. Il existe cependant bien un sentiment commun qui permet aux Réunionnais de qualifier une case de "créole" ou non, à l'aide de certains éléments dont nous avons cité les principaux précédemment.
L'art d'habiter réunionnais va bien au-delà d’une simple fonction : au savoir-faire était toujours associé le savoir-plaire. Précieuses, variées et toujours d'actualité, les cases créoles témoignent d'un souci de création sans cesse ravivé. Mais la case créole n’est rien, sans son fidèle jardin.
B). Les jardins créoles
1). Un peu d'histoire...
Les jardins créoles : c’est ainsi que l’on appelle les jardins de l’île de La Réunion (le mot « créole » désignant tout ce qui est insulaire à cette dernière, que ce soit l'homme, la cuisine, un certain art de vivre...). Ils sont le résultat d'apports extérieurs variés : malgaches d’abord, puis européens avec la prise de possession par les Français en 1642, puis indiens, arabes et chinois. En effet, depuis le XVII siècle, règne des grands voyages à travers le monde, des échanges nombreux se font entre les îles et les continents. La quête des épices fait découvrir la richesse extraordinaire de la végétation tropicale, et l’île de la Réunion devient bien vite une étape incontournable des routes maritimes. Au fil des années, La Réunion se peuple ainsi de plantes utiles et ornementales en provenance du monde entier. Son climat tropical humide et ses microclimats dus à son relief tourmenté permettent l'adaptation de centaines d'espèces. De plus, des « jardins d’acclimatation » sont créés, dont le plus célèbre est le Jardin Colonial (aujourd’hui appelé Jardin de l’État), qui accueillent dans de grandes serres les nouvelles espèces introduites dans l'île, afin de favoriser leur acclimatation, serres desquelles les habitants peuvent prélever des boutures afin de les planter eux-mêmes dans leurs jardins.
2). Les caractéristiques du jardin créole
• Le baro
Avant de pénétrer un jardin créole, il faut d'abord franchir un portail, le « baro », qui est la séparation entre l'espace public de la rue et l'espace privé. Il marque ainsi le seuil du domaine, franchi que sur invitation. Il en existe de toutes sortes, mais qu’il soit modeste ou monumental, il contribue à la mise en scène du jardin et témoigne de la richesse des propriétaires.
• L'allée centrale
Une allée centrale mène alors le visiteur qui pousse le baro, directement de ce dernier à la varangue. Elle matérialise l’axe de symétrie de part et d’autre duquel s’ordonnent les plantations. Cette symétrie est d’ailleurs un exemple des inspirations européennes que l’on retrouve dans les jardins créoles : ici celle des jardins réguliers très en vogue en France sous le Second Empire. Ces modèles de référence ont cependant subi des adaptations locales, les tracés étant par exemple simplifiés et l’allée principale réalisée en tuiles plates.
• Le jardin de devant
Le visiteur qui continue alors son chemin se trouve en vérité dans ce que l’on appelle le « jardin de devant ». Il est celui qui accueille et s’offre au regard de l’hôte. C’est donc un jardin d’apparat aux multiples couleurs, destiné à être admiré : il s’agit du faire-valoir de la case. On y retrouve les plus belles fleurs, et les plus beaux parterres ; les arbres au contraire y sont rares, la vue devant rester dégagée. Ce jardin de devant est caractérisé par un véritable foisonnement, c’est-à-dire que cette partie du jardin va être entièrement remplie, sans aucun espace de terre visible. C’est là tout son esprit : réunir le plus de plantes possible dans un petit espace, où tout est mélangé. Cela donne lieu à une véritable abondance de plantes organisées dans un joyeux fouillis : les fleurs de différentes tailles, formes et couleurs ploient au-dessus des murs et des allées ; les herbes et les arbustes à haies s'entassent parmi les lianes et les buissons fleuris. Ce jardin de devant est en floraison perpétuelle, les nouvelles fleurs masquant celles qui se fanent. Ce semblant désordre n'en est cependant pas un: les plantes sont agencées de manière à occuper une « niche écologique » qui permet leur coexistence et accroît même leur rendement. En effet, certaines plantes offrent des « services » et bénéficient aux autres (par exemple pour capter puis fournir de l’azote aux autres plantes, mieux couvrir le sol et éviter l’érosion, etc…) : ainsi, par des cultures associées, ces plantes contribuent à un processus efficace profitant à l’ensemble du jardin. De plus, les plantations restent maîtrisées et soigneusement entretenues, les parterres étant quotidiennement désherbés et les végétaux régulièrement taillés. Les plantes qui accueillent le visiteur ont également souvent une valeur symbolique. Elles servent à protéger la maison et ses habitants du « mauvais œil » à lui apporter bonheur, chance ou richesse (on peut par exemple citer la « plante de la chance », qui est la Cordyline). Elles peuvent aussi être défensives de par leurs attributs (épines), et symboliquement, elles protègent la maison contre l'extérieur. Au moment de l'emménagement dans une maison, la première plante qu'on introduit dans le jardin est la songe papangue ou songe caraïbe (Colocasia grandiflora) qui a pour but de porter chance aux nouveaux habitants et d'éviter les mauvais sorts.
• La varangue
Les pas mènent alors à la varangue, qui crée la continuité avec le jardin. Légèrement surélevée, elle est un lieu de repos. Là, y poussent capillaires et plantes rares mises en valeur sur des guéridons. Les varangues sont souvent très ombragées, parfois même obscures, et deviennent ainsi une sorte d’intermédiaire entre la lumière vive du jardin, et la maison. Certaines cases créoles possèdent également une terrasse nommée guétali, au coin du jardin, permettant d'observer la vie de la rue sans être vu. On s’y assoit à la tombée de la nuit pour profiter de la fraîcheur et observer le va-et-vient de la rue.
• Le jardin de derrière
Mais il existe également un autre jardin, le jardin de derrière, qui représente un monde complètement différent du jardin de devant, tant du point de la fonctionnalité que de l'apparence. L'arrière est en effet un espace caché, intime, réservé aux proches de la famille. Une petite porte opaque et discrète, le ti-baro, permet d'y accéder, en longeant la case, directement depuis le premier jardin. Il s’y déroulent les activités quotidiennes, comme celle du lavage ou de l’étendage du linge par exemple, ou encore celle de l’élevage des animaux (poules, canards...) courant chez les créoles. Si le jardin de devant est composé de plantes avant tout esthétiques, le jardin de derrière, au contraire, est celui des plantes utilitaires. On y trouve tout d’abord de nombreuses plantes destinées à la consommation, telles que des plantes potagères (ignames, aubergines, amarante (“ épinard ”)), mais aussi des épices (piment, quatre épices, gingembre...) et des herbes (citronnelle, romarin…) qui agrémenteront leur préparation. On y trouve ensuite des plantes médicinales (cannelle, thé des Antilles (“ thé-pays ”), pimenta (“ bois d’Inde ”), eupatoire (“ guérit-tout ”)...) et enfin des “plantes à parfum” (géranium, vétiver, patchouli…). Le jardin créole est également très souvent planté de citronnelle ; on en brûle les feuilles séchées pour éloigner les moustiques. L'aspect pratique des plantes prime donc dans ce jardin de derrière très clairement sur la recherche esthétique. Une autre caractéristique de ce dernier est la présence d’une ombrière, sorte de serre, destinée à protéger les plantes les plus fragiles - telles que les fougères ou les orchidées - des rayons mordants du soleil tropical.
3). Conclusion
En conclusion, le jardin créole est un véritable art de vivre. Il est devenu un moyen d'expression privilégié dans l’île, et montre l'harmonie de ses habitants avec la nature. Peuplé de plantes venues de toutes les régions du monde, influencé par les voyages et les récits de voyageurs, prenant un peu des jardins à la française, un brin de l'influence anglaise et un zeste de l'esprit persan, le jardin créole constitue de par sa variété et son style qui lui est propre, un véritable patrimoine pour l’île et lui donne son nom "d'île-jardin".



Les cases créoles de La Réunion sont différentes de ces cases définies par certains dictionnaires français comme « des paillotes et des huttes, de pays tropicaux ou exotiques ». Ce sont en effet des maisons nées de la rencontre des cultures qui se poursuit dans l'île depuis le XVIe siècle. Elles ont été figées sur des clichés dès les premiers âges de la technique photographique, à la fin du XIXe siècle.
La Réunion fait partie de l'Archipel des Mascareignes comprenant trois îles volcaniques émergées du fond de l'océan Indien : Maurice, Réunion et Rodrigues. Ses origines remontent à trois millions d'années. Découverte par les Arabes vers le Xe siècle, puis redécouverte par les navigateurs portugais au XVIe siècle, elle ne sera longtemps qu'une escale inhabitée sur la route des Indes. Les Français implantés à Madagascar
prendront plusieurs fois possession de l'Île qu'ils appelleront Bourbon, sans pour autant l'habiter. Entre 1646 et 1658, elle servira de terre d'exil pour les mutins et les rebelles de la Grande Ile. Bourbon sera colonisée à partir de 1665 par Etienne Regnault, commandant de la Compagnie des Indes Orientales. Le premier quartier est créé dans la baie de Saint-Paul, les huttes des premiers occupants font alors place à des petits ensembles de constructions en bois. Lorsqu'en 1671, le commandant Etienne Regnault est relevé de ses fonctions, il recommande dans un rapport adressé à la Compagnie, l'envoi d'une main-d'oeuvre qualifiée pour développer la colonie :
"Les ouvriers qu'il s'agit d'y mener sont charpentiers de maisons et navires, menuisiers, charrons, tourneurs, maçons, tailleurs de pierres, taillandiers, maréchaux, serruriers, armuriers, tuiliers, potiers de terre, vanniers, charbonniers, cordiers et quelques architectes."
Les cases existent sous différentes formes. Qu'elles soient en « bois sous tôle» ou en « béton sous tôle», elles sont toutes différentes, mais conservent tout de même un même air de famille. Toits en tôles aux couleurs variées, moulures colorées en losange, l’indispensable varangue, le « baro » (le portail) qui "protège la politesse autant que la distance” dans la tradition: tant d'éléments que l'on retrouve dans la plupart des cases créoles. Le patrimoine architectural de la Réunion peut être regroupé en deux grandes familles. D'une part, l'architecture monumentale comprenant les magasins de la Compagnie des Indes, les bâtiments militaires, publics, cultuels et industriels, et, d'autre part, l'architecture domestique, composée des cases créoles et des ensembles urbains anciens. Plus modestes mais aussi présentes, les cases en « tôle sous tôle » ne respirent pas l'abondance, mais font tout autant partie du patrimoine architectural réunionnais. Au cœur d'un village ou isolées en pleine nature, elles colorent l'île de touches chaleureuses, tellement présentes qu'on ne peut imaginer leur absence. « Dans les villages ou au détour d'un chemin, elles restent entourées de fleurs : à proximité des villes ou au fond d'une campagne isolée, elles s'apparentent davantage à des constructions de fortune qui durent malgré la vétusté. » selon Yves Hots.
• Les lambrequins
Objet de décoration par excellence, le lambrequin fait partie intégrante de l’architecture créole. En plus de son rôle décoratif, il favorise l'écoulement des eaux provenant de l’auvent situé au-dessus des ouvertures de la maison. Ainsi les eaux de ruissellement, freinées par sa surface, se retrouvent transformées en goutte à goutte ce qui a pour effet de ne pas provoquer le déchaussement des fondations. Cela permet aussi d’irriguer les plantes ornementales se trouvant en aplomb, juste en dessous des fenêtres. Après la Seconde Guerre mondiale, on a abandonné la fabrication de lambrequins en bois au profit de l’acier nouvellement introduit dans l’île. Aujourd'hui ils sont surtout en métal peint, mais offrent toujours des motifs originaux et variés Plus résistants dans le temps, ils représentent dans l’imaginaire collectif à eux seuls le style architectural créole, et sont le symbole d’un certain art de vivre. Leur originalité réside dans la recherche de formes souvent inspirées de la nature.

• La varangue
Traditionnellement liée à la case réunionnaise, la varangue est couverte, située devant la façade et souvent ouverte sur le jardin. Directement inspirée de l’habitat des colonies indiennes, elle permet de recevoir les visiteurs de passage en préservant l’intimité de l’intérieur, autant que de se laisser aller à la douceur du farniente ou de la discussion, à l’abri de la chaleur. Elle constitue le lieu de transition entre l’extérieur et l’intérieur de la maison. L’intérieur de la varangue est isolé de l’humidité et permet la régulation thermique du salon. Largement ouverte sur le jardin créole, elle est généralement encadrée de deux petites pièces qui servent de bureau ou de chambre de repos. Les plus belles sont décorées de motifs architecturaux de bois (impostes qui s’inspirent de l’art du rinceau, colonnettes ajourées en forme de balustre, lambrequins…) finement ouvragés. On retrouve aussi traditionnellement, un fanjan rond de capillaires placé sur une petite table au centre de la pièce.

• Les murs de la case, des bardeaux aux couleurs "In souflaz bardo"
La façade est parfois revêtue de bardeaux. Sorte de petites tuiles taillées manuellement dans du bois de tamarin, de nattes ou de palissandre, excellent isolant thermique et phonique, les bardeaux étaient couramment utilisés pour les toitures ou la couverture des murs. Ils permettent de faire glisser les gouttes de pluie et constituent une excellente protection contre le vent. Aujourd’hui concurrencé par des produits moins onéreux comme la tôle ou le zinc, il est devenu un produit rare travaillé par seulement quelques artisans. Aujourd’hui, il ne reste que deux tailleurs de bardeaux à la Réunion. Cependant, les cases créoles sont aussi parfois simplement de couleurs extravagantes. Alors que les grandes cases en bois sont le plus souvent peintes en blanc, les petites en bois et en tôles sont généralement recouvertes de couleurs vives, parfois en camaïeu. Rose, orange, vert, rouge, bleue ou pourquoi pas vert d’eau à l’image de l’immense villa Déramond-Barre ? Dont l’arrière est justement recouvert de bardeaux.


• Les battants créoles
Les portes extérieures à double battant sont consolidées par des traverses en Z (port à Zèd).
L’un des battants est muni d’une bascule qui en pivotant sur l’axe central pour se bloquer sur les taquets (taso baskil) du chambranle permet la fermeture des portes.
La majorité des maisons créoles étaient composées de quatre versants qui permettaient à l’air de mieux circuler entre les pièces, mais aussi, et surtout, à limiter les éventuelles secousses que l’on ressentait dans les îles en période de cyclones. Les baies des fenêtres ont des contrevents suivant le même système et ayant le même motif, mais sont souvent encore plus colorées.

• Les modénatures créoles
“La case entr'ouvre ses paupières-losanges sous la protection de Vénus” écrivit Christian Barrat. Les modénatures sont souvent blanches ou de couleurs vives : le but est de créer un contraste avec la couleur de la maison. Assorties aux contrevents et aux châssis vitrés, elles mettent en valeur même les façades dépourvues de varangues. Il en existe de toutes les formes, du losange au rectangle. On peut également retrouver en leur centre des motifs. L’étoile à douze branches, à l’image de la roue de charrette traditionnelle à douze rayons est fixée au centre d’un losange : cette figure est souvent utilisée pour les modénatures de façades des petites cases de bois et exceptionnellement comme ici, dans les châssis vitrés.
• Un avant et un arrière
À l'image de la maison Foucque, l'habitation créole modeste répond à une organisation fonctionnellement hiérarchisée. Sur l'avant, côté rue, dessinés en symétrie, la clôture, le jardin et la façade principale de la case sont parés de leurs plus beaux atours offerts à la vue du public. Les flancs et l'arrière de la parcelle, plus rustiques, sont réservés à la vie domestique et comportent notamment cuisine, dépendances, godons, lavoir, poulailler, volière et parc tortue.


Le second type de toits traditionnels créoles est dit en tapénak : il est à quatre versants formants au sommet desquels se trouve un faîtage parallèle au plan de la façade de la case.
Les toitures en pente de ces deux types de toits favorisent l’étanchéité et les débords ainsi que les auvents protègent les façades et leurs ouvertures.
Ils sont très souvent de couleur rouge, mais l'on peut parfois retrouver d'autres couleurs.
• La toiture
Il existe deux types de toits traditionnels de cases créoles. Tout d'abord le toit en pavillon (dit "pavyon" en créole), qui est d'une forme évasée souvent comparée à une tente. C’est une toiture dite pyramidale à quatre pans et une seule pente.
bottom of page